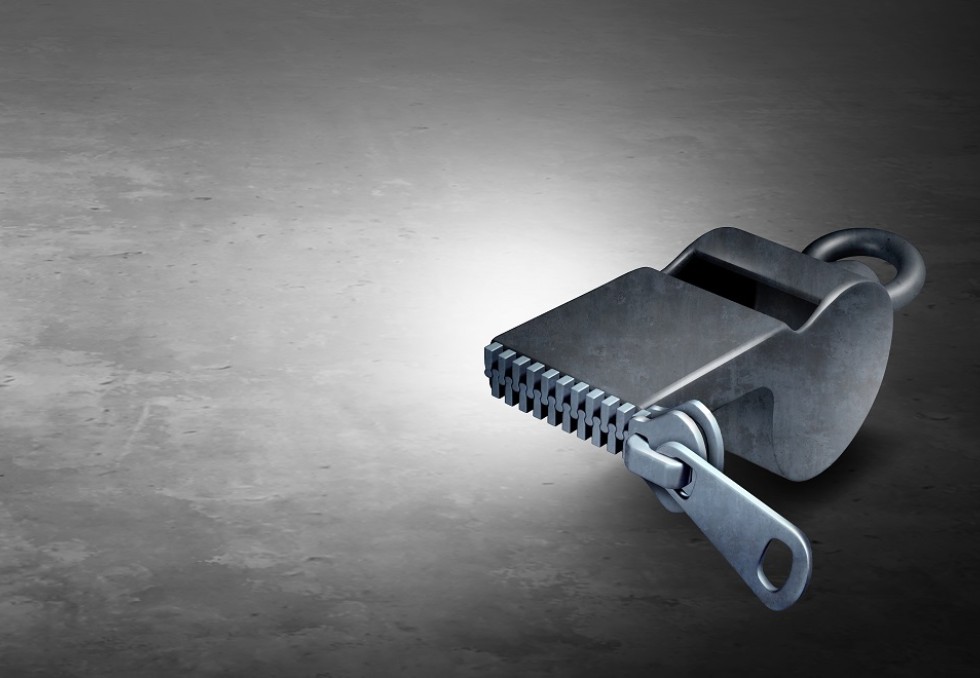
Trois soignants se suicident tous les deux jours : "Avant on nous disait de ne pas en parler pour ne pas abîmer la profession"
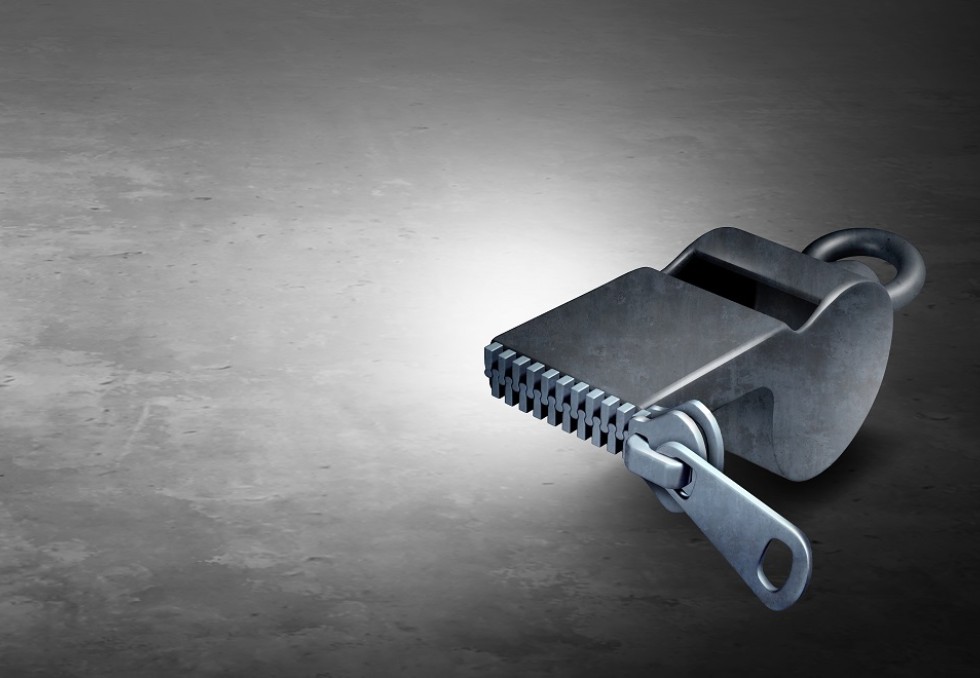
"Nous sommes des lanceurs d’alerte", déclare le Dr Éric Henry, médecin généraliste à Auray (Morbihan) et président de l’association Soins aux professionnels de santé (SPS). Ce mardi 30 août, SPS présentait sa campagne de prévention contre le suicide des soignants : un film choc mettant en scène trois professionnels de santé (médecins et infirmières) s’ôtant la vie sous les yeux médusés d’une patiente hospitalisée. Des images rarement visibles, mais dont la diffusion semble aujourd’hui nécessaire pour "éveiller les consciences" sur ce "tabou" que représente le suicide de ceux qui nous soignent, estime le Dr Henry.
Qui nous soignera quand les professionnels de la santé ne seront plus là ?
Avant d’en arriver là des solutions existent, contactez SPS au 0805232336 ou téléchargez l’application SPS #santementale #preventionsuicide pic.twitter.com/KyNs8B9k1r— Association SPS (@AssoSPS) August 30, 2022
"Le suicide est un sujet tabou parce que c’est un constat que notre société serait pathologique", ajoute le praticien, qui confie être lui-même "fils de suicidé de l’Éducation nationale des années 1970". Si plus de 9.000 décès par suicide sont enregistrés chaque année en France (d’après les données de l’Inserm datant de 2017), les professionnels de la santé sont loin d’être épargnés. Mais "personne ne le voyait ou bien tout le monde refusait de le voir" jusqu’ici. Par cette campagne, SPS expose aux yeux de tous – soignants eux-mêmes, patients et pouvoirs publics – le "cri de douleur" des professionnels de santé. Se basant sur les chiffres officiels, "qui mériteraient d’être actualisés", l’association évalue à "trois le nombre de soignants se suicident tous les deux jours". "Pour ne pas être pris en défaut, nous sommes restés très factuels et sommes partis des chiffres de la population classique. Il y a donc probablement plus de suicides que trois tous les deux jours", nuance Eric Henry. Dans sa définition de soignants, SPS inclut l’ensemble des professionnels de la santé : professions médicales et paramédicales, mais aussi administratives (cadres de santé, directeurs d’établissement…), professions médico-sociales et d’autres métiers (chiropracteurs, ostéopathes, vétérinaires…). Ce qui, au total, représente un groupe de 3.5 millions de personnes. "Les chiffres qui concernent les soignants sont catastrophiques", rapporte Magali Briane, psychiatre et vice-présidente de l’association. Plusieurs études montrent en effet la réelle souffrance de ces professionnels. L’étude Stéthos (2017) pour SPS montre qu’au cours de leur carrière, 25% d’entre eux ont déjà eu des idées suicidaires liées au travail. En 2021, l’Intersyndicale nationale des internes (Isni) relevait 1 suicide d’interne tous les 18 jours. Un interne a d’ailleurs trois fois plus de risque de se suicider qu'un Français du même âge. Plus récemment, en 2022, l’étude Amadeus montrait que 50 à 60% des soignants à l’hôpital souffraient de burn-out. Une part non-négligeable était par ailleurs sujette à la dépression, à des troubles du sommeil ou à des comportements à risque (tabagisme, alcool…). La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’a fait qu’exacerber les difficultés déjà rencontrées par les soignants. "Maltraitance institutionnalisée" Magali Briane identifie deux principaux déterminants spécifiques aux soignants. En premier lieu, la charge émotionnelle importante liée à leur exercice, qui se traduit par une sur-sollicitation. "Quand des proches me demandaient ‘Comment tu fais pour faire face à la souffrance de tes patients ?’. Je répondais ‘Je sors de mon cabinet, je monte dans ma voiture et c’est fini, je pense à autre chose’. Je sais maintenant que ce n’est pas vrai. Mais moi, j’ai des outils de régulation émotionnelle pour faire avec ça. Tous nos soignants ne les connaissent pas", explique-t-elle. La psychiatre note également une forme de stigmatisation de la souffrance des soignants. "Il faut arriver à renforcer leurs ressources personnelles et leur dire que c’est normal qu’ils souffrent. Quand les jeunes arrivent dans leurs études, on ne leur dit pas ça. Au contraire, on leur dit qu’ils vont être soignants et qu’ils vont devoir être forts. Car si tu n’es pas fort, tu ne peux pas soigner les autres. Ce n’est pas vrai. On peut très bien soigner, même si soi-même on pleure parfois. Cela ne fait pas de vous de mauvais soignants. Or aujourd’hui les étudiants qui vont mal s’isolent ", constate la spécialiste. Laurence Marbach peut en témoigner. Le 12 mai 2019, l’une de ses trois filles, Élise, s’est suicidée. Elle était interne en gastro-entérologie à Lyon. "C’était une jeune fille qui aimait son boulot." "Un jour elle me racontait les difficultés qu’elle rencontrait dans son travail. Je lui ai demandé pourquoi elle n’en parlait pas autour d’elle car elle avait des idées, des solutions. Elle m’a répondu avec le sourire : ‘Je suis qu’un petit interne, dans trois mois, il y aura un autre esclave à ma place’. Deux mois après, elle était morte." Dans leur combat pour comprendre ce qui avait poussé leur fille à passer à l’acte, Laurence Marbach et son mari se sont rendu compte qu’elle souffrait d’épuisement professionnel. "Elle bossait jusqu’à 80/90 heures par semaine, elle n’en pouvait plus, elle enchaînait les gardes, les astreintes de week-end. Elle a fait une attaque de panique." Durant l’année qui a suivi le décès de sa fille, Laurence Marbach apprend les suicides d’autres étudiants en médecine. Un an après, le 12 mai 2020, elle lance la ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (Lipseim). "Ce n’était plus possible de continuer comme ça, avec cette espèce d’omerta, d’immobilisme, de maltraitance institutionnalisée", raconte la DRH de formation, qui a fait du temps de travail des internes son "cheval de bataille".
"L’Etat est en-dessous des attentes" Malgré ces données alarmantes et ces drames, Éric Henry déplore lui aussi "l’omerta" qui entoure toujours le suicide des professionnels de la santé. "Les soignants vont mal : ça, tout le monde l’a vu car beaucoup ont déserté. On l’a constaté notamment cet été avec des services d’urgences fermés un peu partout. Le tabou de dire que les soignants allaient bien a ainsi été brisé. Mais il y a un autre tabou qui est au bout de la souffrance : il s’agit du suicide. Celui-là est complètement bloqué depuis quarante ans."
Le généraliste déplore que soit mis en avant l’effet Werther lorsqu’il s’agit du suicide, selon lequel il existerait un "effet de contagion", à la différence de l’effet Papageno qui aurait, lui, un effet "préventif". "On nous a dit que c’était un sujet que l’on ne pouvait pas aborder, car si on le faisait, on augmenterait le nombre de suicide en France. C’est faux !" L’association assure avoir tenté d’alerter les autorités à maintes reprises sur ce fléau : "En 2015, on nous disait il ne faut pas parler de la santé des soignants pour ne pas abîmer l’image de la profession, rapporte Catherine Cornibert, pharmacienne et directrice générale de l’asso. Aujourd’hui, on ose." Montrer des personnes qui se suicident permet, selon le Dr Henry, de prouver que le suicide existe, car "ce que l’on ne voit pas n’existe pas". Or à l’association, on y est confronté chaque jour avec les appels sur le numéro vert. Plus de 19.000 appels ont été passés depuis 2016 – dont les trois-quarts depuis 2020. "Depuis deux ans, nous avons reçu plus de 40 appels de personnes qui avaient des idées suicidaires imminentes. Peut-être qu’on les a sauvées", espère Catherine Cornibert.
La pharmacienne souligne que le numéro vert SPS est le seul à avoir "100% de décrochés". Ce qui n’est pas le cas du 3114, le numéro national de prévention du suicide mis en place dans le cadre du Ségur de la santé*, ajoute-t-elle. "Nous avons chez SPS globalement 1 million d’euros pour 3 millions de Français, et nous arrivons à être 100% joignables. La ligne 3114 a obtenu 20 millions d’euros pour 60 millions de Français. On est au même ratio financier. Les associations qui récupèrent cet argent font des choix politiques. Peut-être qu’elles décident de dépenser leur argent différemment, plus loin dans le parcours, mais pas sur la plateforme. Je pense que c’est une erreur. Quand on va à la pêche avec un filet à trous, on revient sans poisson", déplore le Dr Henry. "Si personne ne répond, c’est fini. Il n’y a pas d’à peu près dans le suicide." SPS a néanmoins conscience qu’elle ne peut à elle seule "révolutionner le système de soins en France", elle espère par le biais de cette campagne faire comprendre à l’Etat "qu’il est en dessous des attentes et qu’il est nécessaire qu’il donne les moyens", explique Éric Henry. Pour les soignants, et l’ensemble des Français. Aujourd’hui, la France a un taux de mortalité de suicide "3% au-dessus des chiffres des autres pays européens", relève Catherine Cornibert, qui veut "réveiller les acteurs". Le président de SPS interpelle ainsi le ministre de la Santé. "Je le remercie déjà car en deux ans il y a eu une évolution", souligne-t-il, faisant ici référence au dispositif MonPsy. "Même si ça n’a pas vraiment fonctionné, l’intention est là." Mais le Dr Henry veut aller plus loin. Créer des sentinelles républicaines L’association ambitionne à terme de toucher toute la population car, constate le Dr Henry, "le tabou du suicide est installé dans toutes les couches de la société". "Je suis venu à SPS pour la thématique du suicide", confie-t-il. "Je considère SPS comme une expérimentation de prise en charge psycho-psychiatrique d’un groupe. Maintenant que l’on a prouvé que cela marche avec un numéro, une appli, un réseau, des cliniques dédiées, et une maison des soignants, on peut dupliquer cela à tous les professionnels : de la Justice, de l’Education nationale… Il n’y aura plus qu’à devenir universel et à s’attaquer au monde de l’entreprise, et tous les Français seront couverts. Là, on aura vraiment réussi une révolution dans notre société." Il propose par ailleurs de former un maximum de Français à "repérer les personnes suicidaires", en créant des postes rémunérés par l’Etat. Des "sentinelles républicaines" en somme, explique Éric Henry. "Elles seraient les vigies de notre société, aptes à repérer et à orienter."
Pour identifier les soignants en souffrance, le généraliste suggère également aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) de créer un module santé des soignants. "Aujourd’hui, beaucoup ont oublié d’inclure cela dans leur projet. Il suffit de former un ou deux généralistes à la prévention du risque suicidaire, deux ou trois psychologues, et de désigner un psychiatre de référence dans une clinique à qui on peut s’adresser si l’on veut hospitaliser quelqu’un rapidement si besoin." Ceci pourrait être bénéfique à toute une population d’un bassin selon lui, pas seulement aux soignants : "Si on arrive à faire ça dans toutes les CPTS de France, dans trois ans, ces groupes pourront être utiles pour tous les Français, et on aura installé de la psycho-psychiatrie légère au pied de la maison de chaque Français." * Le taux de décrochés est de 75% selon le site du Gouvernement.
"Qui nous soignera quand les professionnels de la santé ne seront plus là ?" La question posée par SPS dans sa campagne de prévention contre le suicide est "déjà tristement d’actualité pour les sages-femmes" qui "quittent les maternités et leur profession". "Le glas a commencé à sonner" pour "le plus beau métier du monde", déplore Christine Chalut Morin, sage-femme clinicienne et docteure en psychologie. Membre de l’association SPS, la Dre Chalut Morin dresse un "constat alarmant", s’appuyant sur une étude menée en 2019 auprès de sages-femmes. "Elle montre qu’une grande majorité des sages-femmes souffraient du syndrome d’épuisement émotionnel : 31% des sages-femmes libérales, 43% des sages-femmes cliniciennes salariées et 66% des sages-femmes coordinatrices."
La Dre Chalut Morin note également une "surcharge de travail", des "exigences émotionnelles" et une "absence de reconnaissance", qui épuisent les sages-femmes. Si elles se sentent compétences pour accompagner les étudiants dans l’apprentissage de leur futur métier, "les sages-femmes n’en ont pas le temps". "Cette absence de compagnonnage contribue probablement au mal-être des étudiants sages-femmes", ajoute la praticienne, citant une autre étude, cette fois de l’ANESF, qui indique que 70% des étudiants sages-femmes souffrent de symptômes dépressifs.
"Qui accouchera les femmes quand les SF ne seront plus là ?" s’interroge la Dre Chalut Morin qui rapporte "deux suicides de sages-femmes au cours des huit derniers mois et une tentative de défenestration sur le lieu de travail le mois dernier". "Pour leur sauvegarde psychique, nombreuses décident de renoncer à exercer leur profession."
La sélection de la rédaction




Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?
Blue GYN
Oui
Tout dépend comment on pose la question. - Tout travail mérite salaire et il faut arrêter de râler sur tout et en permanence, (Arr... Lire plus