Depuis le 13 mai dernier, le Gouvernement a confié aux médecins un rôle clé dans la collecte et le partage d’informations sur les patients diagnostiqués positifs au coronavirus et sur leurs contacts. Une perspective qui a beaucoup inquiété la profession, à tel point que les autorités ont dû substantiellement revoir leur copie. Retour sur les enjeux de ce revirement. Cinq jours. C’est le temps qui s’est écoulé entre deux communiqués de presse du Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom). Deux publications au ton radicalement différent. La première, le 7 mai dernier, « exhort[ait] le Gouvernement à garantir le respect du secret médical » dans le cadre du traçage des patients infectés par le coronavirus. Dans la seconde, le 12 mai, les ordinaux se déclaraient, sur cette question, « satisfait[s] des garanties données par le Gouvernement et des avancées apportées par le débat parlementaire au projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire ». Que s’est-il passé pour que les gardiens de la déontologie médicale, et avec eux bien d’autres représentants de la profession, opèrent une aussi spectaculaire volte-face ? Pour le comprendre, il faut remonter aux versions préparatoires de la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire, adoptée après d’intenses tractations et de nombreux amendements, le 9 mai dernier, par le Parlement et modifiée à la marge, les jours suivants, par le Conseil constitutionnel. Entre autres dispositions pour encadrer le déconfinement du pays, le projet de loi définissait les modalités de fonctionnement du traçage des patients infectés par le coronavirus et diagnostiqués par les médecins, ainsi que de leurs contacts. Et sur ce point précis, les premières moutures du texte ont suscité de fortes inquiétudes au sein de la communauté médicale.
Une rare unanimité Le 6 mai dernier, le syndicat Avenir Spé avait ainsi lancé, dans un communiqué, « une sérieuse mise en garde » à ce sujet, estimant que le projet posait « des problèmes de secret médical, d’éthique pour le médecin, et de respect du droit des patients ». Mais le syndicat de spécialistes était loin d’être le seul à tirer la sonnette d’alarme. Parmi les acteurs médicaux qui alertaient alors sur les dangers du projet, on retrouve le Syndicat des médecins libéraux (SML), qui estimait, dans un communiqué cité par l’agence APMNews, que les médecins libéraux étaient « prêts à participer activement » à la recherche des cas possibles, mais qu’ils...
« ne sacrifier[aient] pas leurs principes éthiques et déontologiques ». Le Collège national des généralistes enseignants (CNGE) estimait, de son côté, dans un autre communiqué publié le 6 mai dernier, que « la question du partage du secret médical [devait] être clarifiée ». Pourquoi une telle unanimité – chose relativement rare – dans l’univers médical ? « Le dispositif proposé porte atteinte à deux droits fondamentaux, expliquait, dans un communiqué, l’Académie nationale de médecine le 5 mai dernier. D’une part, il permet la circulation de données personnelles de santé, “le cas échéant hors le consentement des intéressés”, créant une exception à la libre volonté des personnes ; d’autre part, il introduit une nouvelle dérogation au secret médical. » L’institution bicentenaire se demande ainsi, en une question toute rhétorique, si l’état d’urgence sanitaire peut « justifier une mesure d’exception qui bafoue deux droits majeurs de notre système de santé ». Question à laquelle elle répondait par un retentissant « oui… mais » à condition que sept modalités soient remplies, notamment la possibilité « pour toute personne informée de son infection Covid-19 de s’opposer à la transmission des informations la concernant, sans que ce choix n’ait de conséquence sur sa propre prise en charge médicale ». L’Académie nationale de médecine demandait également l’établissement d’une liste stricte dénombrant « les autorités et les salariés ayant accès à ces informations », ainsi que la garantie que les systèmes d’information créés soient « hautement protégés », et qu’ils fonctionnent « uniquement pendant une durée limitée, ne devant en aucun cas excéder le temps nécessaire à la lutte contre l’épidémie ».
Des applaudissements pour les parlementaires ? Face à de telles mises en garde, le Gouvernement avait deux solutions : faire passer le dispositif en force (au risque de déclencher un conflit majeur avec la profession médicale en pleine crise sanitaire) ou laisser les députés et les sénateurs amender le texte (pour prendre en compte les préoccupations des médecins inquiets pour leur serment d’Hippocrate). La deuxième solution a été choisie, et « c’est un bon exemple de l’intérêt du travail des parlementaires », se félicite le Dr Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, qui a activement participé aux discussions. Cette rhumatologue de profession estime que...
les deux chambres ont su « être à l’écoute des professionnels qui s’inquiétaient du secret médical, et transformer cette écoute pour améliorer le texte ». Parmi les nombreuses dispositions modifiées par les parlementaires, on trouve notamment des garanties sur l’anonymat des patients diagnostiqués positifs au coronavirus. Sur proposition des députés, ceux-ci peuvent, en effet, demander que leur identité ne puisse être communiquée, « sauf accord exprès », aux personnes qu’elles identifieraient comme ayant été en contact avec elles. En commission mixte paritaire (CMP), les parlementaires ont par ailleurs décidé de limiter la portée du dispositif « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ». La durée de vie du mécanisme doit, en outre, être réduite à celle qui est « strictement nécessaire » au combat contre la diffusion du virus « ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire », précise le texte, qui prévoit, de surcroît, que « les données à caractère personnel collectées […] ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte », alors que le ministère de la Santé privilégiait, pour sa part, une durée plus longue. Les parlementaires ont de plus insisté sur le fait que les données recueillies devront être « strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus […], ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale ».
La sécurité pour le médecin Ce texte ainsi amendé a recueilli les suffrages d’une grande partie de la profession médicale. En atteste la réaction du Cnom, le 12 mai, présentée plus tôt. Mais avant l’Ordre, trois syndicats de médecins libéraux (CSMF, MG France et SML) avaient déjà pris acte de l’évolution du texte, encourageant le médecin généraliste à s’engager « pleinement auprès des patients concernés, en leur expliquant la démarche, l’intérêt du repérage pour la protection de leur entourage, et les précautions prises sur les données qu’in fine il acceptera, ou non, de transmettre à l’Assurance maladie ». « Les éclaircissements apportés au projet du Gouvernement permettent au médecin d’avoir un cadre juridique qui les protège, décrypte le Dr Jacques Battistoni, président de MG France. Ils lui garantissent...
d’être parfaitement dans la légalité en participant à la stratégie de traçage des contacts, qui reste, avec les gestes barrières, la seule méthode efficace pour juguler le virus. » L’alliance de la carpe académique et du lapin SNJMG Reste que malgré ces avancées, certaines institutions de la sphère médicale continuent à émettre des réticences sur divers points du mécanisme de traçage des patients. « Nous avons eu des réponses sur toutes les réserves que nous avions émises, sauf une : celle où nous avions souligné que l’accord de la personne diagnostiquée pour que ses données soient transmises était important », rappelle le Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine. Si la loi encadre le partage des cas contacts, elle classe en effet le Covid-19 parmi les maladies à déclaration obligatoire. Qu’elle le veuille ou non, une personne diagnostiquée doit être inscrite dans le fichier… et le secret médical en prend un coup ! L’une des seules voix du monde médical à rejoindre l’Académie sur ce point n’est autre que celle du Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG). « Nous ne comprenons pas pourquoi on se permet d’outrepasser le consentement des gens, regrette le Dr Benoît Blaes, son président. La plupart des patients accepteront d’indiquer leurs coordonnées. Certes, une infime minorité d’entre eux ne voudront pas, et ils auront peut-être de bonnes raisons pour cela. Imaginons un patient qui héberge des gens qui sont dans l’illégalité, ou qui a du matériel illégal chez lui : il ne voudra pas s’exposer à d’éventuels contrôles, même si ceux-ci ne sont pas précisés dans les textes. »
Jacques Battistoni, quant à lui, tient à tempérer la portée de cette disposition. « Effectivement, nul n’est censé ignorer la loi, et un patient doit savoir que s’il va voir un médecin et qu’il est positif au coronavirus, le médecin devra le déclarer à l’Assurance maladie », reconnaît le président de MG France, qui souligne toutefois que, pour le reste, et notamment pour la recherche active d’éventuels cas contacts, le principe du consentement est respecté. « Il est évident que, pour cela, on ne peut rien faire sans le consentement du patient », souligne le généraliste. Peut-on sous-traiter le secret ? Une autre question a suscité de nombreuses interrogations...
avec qui les médecins peuvent-ils partager les informations sensibles relatives au statut sérologique de leurs patients ? Sur ce point, insistent les syndicats, ce n’est pas le fait de transmettre des données à l’Assurance maladie ou aux agences régionales de santé (ARS) qui est dérangeant. Car, comme le remarque Jacques Battistoni, le partage du secret médical avec les caisses se pratique depuis longtemps. « C’est déjà ce qui se fait quand nous transmettons un volet d’arrêt de travail dans lequel nous mentionnons le motif de l’arrêt », souligne-t-il. Pour sa part, Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam), s’est longuement exprimé dans les médias au moment du vote définitif de la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire pour expliquer que ses équipes avaient l’habitude de traiter des données sensibles. « L’Assurance maladie partage tous les jours des données de santé avec les médecins et les patients : affections longue durée, arrêts de travail, prescriptions…, déclarait-il ainsi, le 12 mai dernier, à nos confrères du Parisien. Raison pour laquelle ce dispositif nous a été confié. » En revanche, l’autorisation accordée aux ARS et à la Cnam, à travers l’article 11 de la loi prolongeant l’état d’urgence, de recourir à des sous-traitants pour réaliser le traçage des cas contacts est plus problématique. Le fait que ces derniers puissent accéder à des données aussi sensibles a pu en effrayer plus d’un.
Mais sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a, le 11 mai dernier, restreint le nombre et la nature des personnes pouvant avoir accès aux données, excluant notamment tous ceux qui relèvent du secteur médico-social. « D’autre part, il est prévu que les professionnels travaillant dans les organismes ayant accès à ces données, même s’ils ne sont pas des professionnels de santé, soient tenus au secret professionnel », rappelle Jacques Bringer. Stéphanie Rist, de son côté, insiste sur le fait qu’il n’est pas inéluctable que les ARS et la Cnam aient besoin de recourir à cette disposition. « Nous avons été obligés d’ajouter cette disposition dans l’éventualité où la quantité de cas ne permettrait pas à ces deux instances de traiter les informations rapidement », explique-t-elle, ajoutant toutefois qu’il est fort possible que l’éventualité en question « ne se présente pas ». « Par ailleurs, ajoute-t-elle, je vois que sur mon territoire [le Loiret, NDLR], les brigades sanitaires qui sont en train d’être créées sont constituées d’agents territoriaux, donc de personnes qui ont une certaine habitude de la fonction publique. Ils s’exposeront d’ailleurs à des sanctions si jamais on s’aperçoit que le secret professionnel n’est pas respecté. » En définitive, même ceux qui se sont élevés avec le plus de virulence contre la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire semblent aujourd’hui considérer que la situation pourrait être bien pire. « Certaines de nos craintes principales ont été prises en compte », reconnaît Benoît Blaes, à l’heure du bilan. « On peut dire que le vase n’est pas tout à fait plein, mais c’est le propre de l’éthique : on est souvent amené à choisir entre deux options qui ont chacune leurs défauts, et à choisir la moins mauvaise », philosophe, de son côté, Jacques Bringer. En d’autres mots, le secret médical n’est pas indemne : il ne pouvait pas l’être en ces temps si particuliers. Mais l’essentiel est sauvé.
La sélection de la rédaction




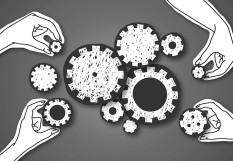
Le montant de la cotisation ordinale vous semble-t-il justifié?
Blue GYN
Oui
Tout dépend comment on pose la question. - Tout travail mérite salaire et il faut arrêter de râler sur tout et en permanence, (Arr... Lire plus